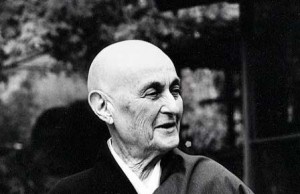Professeure honoraire au Collège de France, ancienne directrice du Laboratoire d’anthropologie sociale, directrice d’étude à l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales), Françoise Héritier est une anthropologue de renommée internationale. Elle a analysé dans de nombreuses sociétés la façon dont on élabore des systèmes de valeurs à partir de la différence des sexes. Ses ouvrages, notamment Masculin/ Féminin (tome 1. La Pensée de la différence; tome 2. Dissoudre la hiérarchie) rendent compte de ces travaux.
Comment en êtes-vous arrivée à ce sujet: l’étude du rapport d’inégalité entre les hommes et les femmes dans les sociétés?
Je n’y suis pas venue par une interrogation personnelle à la suite d’injustices que j’aurais subies, mais au fil de mon travail d’anthropologue. J’ai eu la chance de me retrouver en Afrique, au Burkina Faso, en 1957. C’était mon premier terrain de recherche. J’étudiais alors une population au système de parenté très différent du nôtre, avec un aspect « patriarcal » très marqué : les pères prennent toutes les décisions pour leurs enfants, la filiation passe uniquement par les hommes, les femmes quittent leur famille pour celle de leur époux quand elles se marient, etc. La hiérarchie entre les sexes transparaît déjà dans le vocabulaire de la parenté : toutes les filles nées dans une famille (ou lignage) sont considérées comme les « soeurs » de tous les hommes de cette famille, quelle que soit leur génération. La sœur du grand-père paternel d’un homme est une « sœur » pour cet homme, comme l’est la sœur de son père ou sa sœur proprement dite. Tous leurs enfants sont des « neveux » pour cet homme. Les femmes sont donc rapportées à une génération inférieure: une femme est toujours, en esprit, cadette par rapport à un homme de sa famille. Ce type de système de parenté n’est pas propre à cette société, et il en existe d’autres. Un type de structure de la parenté est toujours une construction culturelle et ne transcrit pas une loi de la nature.
Mais cet exemple m’a mise sur la piste de la «valence différentielle des sexes » : dans la plupart des domaines de la vie ordinaire, y compris dans des sociétés qui n’ont pas ce type de système de parenté, les femmes sont tenues pour « mineures », comme « cadettes » par rapport aux hommes. Pourquoi ?
De façon universelle, l’antériorité vaut supériorité : parce que les parents naissent avant les enfants, ils ont la charge des enfants mais aussi l’autorité sur eux. Et puisque les femmes sont nécessaires aux hommes pour qu’ils aient des fils, les hommes se sont approprié leur corps et les ont traitées sinon comme des objets, du moins comme des cadettes sur qui ils ont autorité.
Avec ce regard, les femmes ont été affectées à la maternité, au domestique, à l’intérieur, à l’intime, alors que les hommes ont accès à l’extérieur, à la vie publique, à l’action. Non pas pour des raisons biologiques, mais par l’effet de constructions intellectuelles.
Vous montrez que, à partir de la différence biologique, naturelle entre les hommes et les femmes, chaque société a inventé un système de représentations qui assigne aux hommes et aux femmes d’autres différences, culturelles, et des valeurs. Pourquoi?
Toute société développe un système de valeurs. Nous ne pouvons penser ou nous exprimer sans utiliser un langage fondé sur des oppositions : haut/bas, sec/humide, chaud/ froid, actif/passif, sain/malsain, pur/impur, etc.
De façon intuitive pour chacun de nous, ces termes sont dotés de l’indice masculin ou de l’indice féminin: «les hommes sont chauds, les femmes sont froides», ou « les hommes sont actifs, les femmes passives ».
On attribue aussi à ces termes des valeurs positives ou négatives. Or, dans chaque culture, ce sont systématiquement les termes associés au masculin qui sont considérés comme positifs. Cela n’a rien à voir avec la définition des termes mêmes, mais avec leur affectation au masculin ou au féminin.
Prenons l’exemple de l’opposition passif/ actif: dans les sociétés occidentales, l’actif est considéré comme masculin et il est donc valorisé. «Actif» est synonyme d’extériorité, de maîtrise sur la nature et les choses. Dans ce système de valeurs, ce sont les hommes – actifs – qui possèdent cette maîtrise, qui transforment la nature et le quotidien grâce à la technique. Dans ce même système de valeurs, on considère les femmes, par opposition aux hommes, comme passives. On le dit aussi dans la métaphore sexuelle.
Or, dans la pensée bouddhiste, ce rapport est inversé. C’est la passivité qui est valorisée et c’est la passivité qui est masculine. La suprême vertu n’est pas de maîtriser la nature par la technique, mais de se maîtriser soi-même. C’est vrai aussi dans le domaine de la sexualité. Il y avait l’idée que le sperme n’était pas renouvelable indéfiniment et donc que les hommes doivent maîtriser leur éjaculation, ne pas gaspiller leur semence. On accorde au contraire aux femmes une activité dans le cadre du domestique qui est sans intérêt, brouillonne.
Dans le premier cas, européen, l’actif est positif car il est associé à l’homme ; dans le second, c’est le passif qui devient positif, du fait qu’il est associé à la masculinité.
Il faut se méfier quand un système de valeurs entend louer « la » femme : quand il la présente comme la Mère, avec une majuscule. Dire que « la » femme n’est respectable qu’en tant que mère revient à la cantonner à la maternité. En renvoyant les femmes à la maternité, on les renvoie au domestique, au subalterne, à l’absence de valeur, en fait, la valeur n’étant reconnue socialement que hors du champ domestique.
Pourquoi associer le féminin au négatif?
Pour maintenir les femmes dans la situation de dominées. Dans la plupart des sociétés traditionnelles, cette domination se traduit par le fait que les femmes ne disposent pas de leur corps, car c’est leur père et leurs frères qui en disposent en les donnant en mariage à d’autres hommes, dont ils obtiennent des épouses en retour. Ces femmes ne choisissent pas leur conjoint, ni le nombre de leurs enfants ; souvent, elles n’ont pas le droit d’aller se faire soigner sans l’accord marital. Elles n’ont pas la liberté d’accéder au savoir; dans beaucoup de pays en développement, elles ne vont que deux ou trois ans à l’école primaire, avant d’être retirées pour être mariées avant que leur esprit ne soit « corrompu» par le savoir. La raison est que trop de savoir ouvre à la possibilité d’exercer son esprit critique. Enfin, les femmes n’ont pas accès au pouvoir
Ce triple refus – du droit à disposer de son corps, du droit au savoir et du droit au pouvoir – est indispensable pour les maintenir dans la dépendance. Nous avons connu cela en Occident et connaissons toujours l’éviction de l’exercice du pouvoir. La meilleure manière de maintenir une femme dans la dépendance et notamment dans l’impossibilité de décider pour elle-même, de comprendre ce qui se passe et de juger de l’injustice du sort qui lui est fait, c’est de lui dire : « Par nature, tu es bête, faible, fragile, et sans moi tu ne pourrais pas exister. »
Le déni, le mépris sont le corollaire obligé de cette volonté de maintenir les femmes dans leur rôle de reproductrices.
Pourquoi ? Les différents mythes que nous ont transmis les sociétés d’autrefois nous montrent les grandes questions que se pose l’humanité. L’une de ces questions pourrait se traduire par : comment se peut-il que les femmes fassent non seulement des corps semblables aux leurs – c’est-à-dire des filles -, mais aussi des corps différents d’elles-mêmes – des garçons -, alors que les hommes n’ont même pas la possibilité de faire des corps semblables au leur ? À quoi servent les hommes ? Question angoissante pour les principaux intéressés.
Comme on avait pu constater aux temps originels que les grossesses n’avaient lieu qu’après des rapports sexuels, on a imaginé la réponse suivante : ce ne sont pas les femmes qui ont le pouvoir exorbitant de faire des enfants par elles-mêmes, mais les hommes qui « mettent » les enfants dans les femmes, comme si celles-ci n’étaient que des réceptacles, des matrices, où prolifère une semence qui vient des hommes.
Dans cet esprit, les enfants sont le trésor des hommes que les femmes ont la nécessité de faire pousser, de conserver pour les hommes. C’est ce qu’on retrouve clairement exprimé dans la pensée du philosophe grec Aristote, où l’esprit, la vie, la forme, le mouvement sont tous dans la semence de l’homme, le corps féminin n’étant que le matériau nécessaire, qui aurait tendance à proliférer vers la monstruosité s’il n’était bridé. Faut-il rappeler le vieux rêve de la procréation sans femme ? Zeus enfante seul.
On voit là à l’œuvre le travail de la pensée à partir du réel observé. Biologiquement, dans la production génétique, les femmes apportent avec les ovules autant que les hommes avec les spermatozoïdes, mais cela n’est connu que depuis la fin du XVIIIe siècle (le début du XXe siècle pour l’apport génétique égal), et n’a pas encore bouleversé nos systèmes archaïques de représentation.
L’origine de la répartition des rôles masculin/ féminin depuis la préhistoire – l’homme chasse, la femme collecte des fruits et graines sauvages – est-elle due au fait que les femmes font et élèvent les enfants?
On invoque souvent, pour expliquer cela, la faiblesse congénitale des femmes, ou encore la fragilité inhérente à leurs grossesses et au fait qu’elles portaient les enfants afin de leur assurer protection le plus longtemps possible. Or, d’après l’expérience que les ethnologues ont des quelque trente-cinq sociétés de chasseurs-collecteurs subsistant dans le monde aujourd’hui, qui vivent en gros comme on vivait à l’époque du paléolithique (avant l’invention de l’agriculture), les femmes parcourent les mêmes distances que les hommes, même avec un bébé dans le ventre, un autre attaché dans le dos, plus la hotte à fournitures sur la tête. Elles ne sont donc pas faibles, et les sociétés ont bien su exploiter leur force et leur endurance.
Les raisons pour lesquelles les femmes ne chassent pas répondent à des impératifs qui relèvent des représentations mentales et du religieux. Les femmes perdent du sang lors des règles. Le chasseur, lui, usant d’instruments perforants, fait couler le sang des animaux. Dans les mondes anciens, on pensait qu’il pouvait y avoir communication, sympathie entre l’humain et la nature qui l’entoure ; on croyait qu’un acte social ou un fait biologique pouvait avoir des répercussions sur la météorologie et le cosmos en général, et réciproquement (comme on dit aujourd’hui encore que chanter faux fait pleuvoir, ou qu’une femme ne peut pas faire prendre une mayonnaise quand elle a ses règles – puisqu’elle-même n’a pas «pris»).
On pensait donc que si une femme faisait couler le sang des bêtes, elle-même ne pourrait plus s’arrêter de couler et que ces hémorragies permanentes entraîneraient la stérilité. Par conséquent, les femmes avaient la permission de chasser à condition de ne pas faire couler le sang : elles pouvaient tuer, mais seulement des petits animaux, et à coups de bâton ou avec des pièges, des lacets ; elles pouvaient tordre le cou à un oiseau, assommer un rat, piéger un lapin, etc. Même si ces représentations ont perdu de leur force ou de leur sens, on constate à la campagne en France que ce sont toujours les hommes qui tuent le cochon ou ailleurs le mouton; même dans les abattoirs où des femmes travaillent, la tâche de tuer ne leur est jamais confiée. Les raisons que l’on donne aujourd’hui à cet interdit de verser le sang – le fait que les femmes seraient du côté de la vie – n’ont rien à voir et reprennent ce faux éloge dont je parlais au début: on vénère toujours la mère dans la femme, pour mieux lui dire: «Attention, reste une mère et ne te mêle pas de ces choses plus importantes que sont la technique, le pouvoir, la religion,le sacré.»
Les dernières recherches scientifiques révèlent pourtant que l’agriculture a très vraisemblablement été inventée par les femmes.
En effet. Depuis très longtemps, depuis que la recherche préhistorique s’est constituée comme science, on a toujours considéré que les progrès techniques, dont l’agriculture, étaient l’œuvre des hommes. Or, récemment, des préhistoriens en sont venus à la conclusion que c’était surtout l’œuvre des femmes. Au paléolithique, ce sont les femmes qui collectaient les fruits et les graines dans la nature, qui ramassaient notamment des céréales sauvages (on peut le constater encore aujourd’hui en Afrique, dans les zones sahéliennes, où les femmes fauchent les plantes sauvages avec une vannerie très serrée pour recueillir de petites graines comme le fonio ou le mil sauvage). Elles rapportaient leurs trouvailles au foyer; parfois des graines tombaient et sans doute certaines devaient-elles germer près du foyer. Peut-être a-t-il fallu des siècles avant que les femmes observent et comprennent ce phénomène et finissent par se dire : « Si ces graines tombées peuvent germer, pourquoi ne pas faire germer des graines de façon systématique pour s’épargner la tâche d’aller les récolter au hasard ? » L’agriculture est ainsi née.
Pour ne pas parler d’autres domaines: par exemple, la participation des femmes à l’art pariétal est attestée, notamment dans les grottes d’Asie du Sud-Est. La technique utilisée était la suivante : on appliquait sa main contre la paroi et on soufflait tout autour les pigments avec la-bouche, si bien que la main était dessinée en creux par le pigment ; la différence de taille des mains indique bien que des femmes participaient à cette décoration.
Comment se fait-il que les techniques, y compris les techniques agricoles, aient été récupérées par les hommes?
Une association s’est produite chez tout enfant entre la nourriture et la féminité, dans la mesure où les femmes nourrissaient au sein les enfants jusqu’à deux ou trois ans. Les femmes ont donc été confinées d’autant plus aisément dans le domestique, la nourriture et la maternité. Or, dans le domestique, le subalterne, il n’y a pas de technique qui tienne. C’étaient les hommes qui se réservaient la technique.
Cependant, l’histoire montre que, au fur et à mesure que l’on avançait et que l’on changeait de techniques, les femmes avaient accès aux techniques abandonnées par les hommes : quand les hommes travaillaient la terre avec des outils en pierre, les femmes la travaillaient avec des bâtons; quand les hommes ont remplacé les outils en pierre par ceux en métal – bronze d’abord, fer ensuite -, les femmes ont accédé aux outils en pierre. Quand les hommes ont découvert l’araire, ils ont laissé l’herminette aux femmes; quand est apparue la vraie charrue avec le soc, les hommes l’ont conduite et les femmes ont repris l’araire, et ainsi de suite jusqu’au tracteur. Chaque fois, les femmes accèdent à la technique – ce qui prouve bien qu’elles peuvent le faire -, simplement elles sont en retard d’un temps parce que les hommes monopolisent toujours la technique avancée.
Nous vivons aujourd’hui dans une société qui n’a plus grand-chose à voir avec les sociétés du paléolithique, mais il nous en reste encore des traces : quand on dit à un enfant qu’il est né parce que «papa a mis une petite graine dans le ventre de maman », c’est toujours la représentation qui veut que la femme ne soit qu’un réceptacle pour l’homme.
Malgré ces constantes, il faut se dire que la valence différentielle des sexes qui est à l’origine des sociétés n’est pas inamovible : en effet, c’est une création de la pensée humaine qui prend différentes formes selon les sociétés, donc ce n’est pas une nécessité naturelle, donc on peut changer les choses. Et, depuis quelques dizaines d’années, les choses changent, par petites touches.
Où finit le biologique, où commence le culturel?
Par exemple, la testostérone (l’hormone mâle) est un fait biologique. Elle peut provoquer une certaine agressivité, qu’il est cependant facile de contrôler, et elle est nécessaire à l’affirmation de soi. Or certains prétendent que, en raison de son important taux de testostérone, l’homme a en lui une violence « naturelle », qu’il ne peut contrôler, ce qui expliquerait certains comportements violents vis-à-vis des femmes. C’est oublier que les femmes aussi produisent de la testostérone, et parfois, en période de stress, d’agitation, de pulsion sexuelle, elles peuvent en produire autant que les hommes.
Deviennent-elles violentes pour autant ? Pas forcément, car la testostérone est contrôlable par le cerveau, la raison. Alors, pourquoi laisse-t-on les hommes se laisser dominer par leurs pulsions ? Pourquoi ne leur dit-on pas, ne leur montre-t-on pas que ces pulsions peuvent être contrôlées ? Reconnaissons toutefois que bon nombre d’entre eux savent les contrôler. On parle ici d’une attitude générale de tolérance. Cela tient à une éducation différentielle.
L’exemple que je vais vous donner vient d’une société fort différente de la nôtre, mais il est très parlant : chez les Samo, une société du Burkina Faso, j’avais remarqué que les femmes ne donnaient pas toujours le sein à leur bébé quand il pleurait. Elles le portaient dans le dos tout en se livrant à leurs activités, et dans certains cas elles s’arrêtaient pour lui donner la tétée, dans d’autres cas elles ignoraient les pleurs ou même se débarrassaient de l’enfant. J’ai fini par comprendre que cette différence de traitement n’était pas fonction de l’urgence de la tâche ou de l’humeur de la mère, mais fonction du sexe de l’enfant : une mère donnait tout de suite la tétée à son enfant si c’était un petit garçon, alors qu’elle le faisait attendre si c’était une petite fille. Elles expliquaient cela par le fait que les garçons ont le « cœur rouge » : ils peuvent se mettre en colère, et c’est dangereux pour leur vie, donc il faut les satisfaire tout de suite. Au contraire, les filles devront attendre toute leur vie et ne jamais être satisfaites, donc autant le leur apprendre dès l’enfance.
Par une telle éducation, on obtient des êtres humains tout à fait différents : ceux qui considèrent que leurs moindres désirs sont des ordres et doivent être satisfaits immédiatement – les hommes – et celles qui apprennent, à peine sorties du ventre maternel, qu’elles seront toujours frustrées – les femmes. Il est clair que de tels comportements ont beaucoup plus d’impact sur les conduites à venir de l’individu que la quantité de testostérone qu’il émet. Même si l’éducation est aujourd’hui beaucoup plus égalitaire en Occident, les garçons comprennent très vite que tout, ou presque, leur est permis et considèrent cela comme naturel; beaucoup trouvent normal, par exemple, de progresser dans leur carrière comme si la question des mérites et des compétences ne se posait pas, qu’ils y ont droit par nature, alors que les femmes s’interrogent toujours pour savoir si elles méritent vraiment une dignité ou un avancement. L’accès aux responsabilités leur est barré, mais de plus elles ont intériorisé l’idée qu’elles n’ont peut-être ni la légitimité ni les capacités nécessaires. Dès qu’il s’agit de carrières qui dépassent les tâches d’exécution, les femmes ne progressent pas de la même manière sur le plan professionnel. À compétence, aptitudes, diplômes égaux, elles sont barrées par un système de choix, de cooptation, de copinage, qui fait que les hommes se choisissent entre eux, etc.
Dans la révolution qu’a connue le XXe siècle en Occident pour le droit des femmes, que considérez-vous comme le plus important?
Les progrès essentiels, en plus des autres progrès légaux qui ont été faits dans nos sociétés et qui sont extraordinaires, sont le droit à la contraception et le droit à l’avortement. Ce sont vraiment des droits fondamentaux, liés au droit à disposer de soi-même, et qu’il faut défendre à tout prix. Le droit à la contraception agit exactement au lieu précis qui a fait que les femmes ont été mises en tutelle, c’est-à-dire au lieu de la reproduction. En effet, le modèle mental archaïque voulait qu’elles fassent des enfants et qu’elles ne fassent que cela, sans leur laisser la possibilité de choisir par elles-mêmes si elles voulaient des enfants ou pas, ou à quel moment.
Sur un plan concret, le droit à la contraception permet en outre aux femmes d’avoir le nombre d’enfants qu’elles peuvent élever. Je ne connais pas – à partir du moment où des soins appropriés permettent à un enfant de vivre – je ne connais pas de société où les femmes souhaitent de leur propre chef avoir dix enfants ou plus. Quand elles les ont, c’est qu’elles y ont été contraintes, soit par la force des choses et l’ignorance, soit par la volonté d’hommes qui tirent richesse et prestige de leur descendance.
Sur quoi aimeriez-vous attirer l’attention des adolescentes aujourd’hui?
Le point le plus important, à mes yeux, est qu’elles réussissent à avoir autant confiance en elles-mêmes que les garçons en eux-mêmes. Apprendre aux filles à avoir confiance en elles est l’un des domaines majeurs de l’éducation où l’on se doit absolument d’agir.
Il faut aussi qu’elles comprennent leur histoire : d’où elles viennent et ce qui reste à accomplir. Les adolescentes aujourd’hui ont l’impression que les droits pour lesquels leurs aînées ont bataillé ont toujours existé. Par définition, elles ne peuvent imaginer un état antérieur, donc elles croient que tout est acquis. Or ce qui est acquis l’est uniquement sur le plan légal. Au quotidien, dans la réalité, il y a encore beaucoup à faire : il faut changer le système de représentations, le système de valeurs, pour que les femmes soient vraiment considérées comme les égales des hommes.
Les adolescentes aujourd’hui ne doivent pas se contenter de penser : « Que me reste-t-il à faire puisque j’ai tous les droits et que je me sens l’égale des garçons dans ma classe ? » Dix ans après, une fois entrées dans la vie – dans leur carrière professionnelle, dans leur couple -, elles découvriront que les choses ne se passent pas du tout comme elles l’avaient imaginé et elles ne seront pas forcément armées pour affronter ces inégalités. Il faut donc leur apprendre la vigilance et leur montrer clairement les domaines où elles ont encore un rôle à jouer. Le fondamental n’est pas derrière elles mais devant elles. C’est à elles et à leurs filles qu’il reviendra peut-être de faire véritablement bouger le socle de représentations archaïques qui accordent aux femmes un statut et des droits inférieurs à ceux des hommes.
Source La fabrique de filles, ouvrage collectif édité par Amnesty International