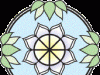Kathleen Raine est l’une des plus grand poètes du XXème siècle. Elle nous parle d’un monde de symboles antiques, un monde dont beaucoup d’entre nous n’ont peut-être pas conscience. Sa conviction est que nous portons tous en nous “le sentiment de quelque chose de connu, la mémoire de quelque chose que nous avions oublié, un assentiment, quelque chose qui nous pénètre ; Platon appelait anamnèse cet éveil d’une connaissance que nous ne savions pas posséder nous-mêmes.”
La description d’états de conscience autres doit, à ceux qui n’ont pas eux-mêmes vécu d’expérience mystique, donner l’impression d’images figuratives ou poétiques. Ceux qui savent sont unanimes à rapporter que les changements de conscience ne relèvent pas d’une question de degré, mais d’espèce. Ils ne correspondent pas à une émotion ou à une excitation fortes, mais à une clarté dans laquelle tout est perçu dans ses moindres détails, comme par un sens plus aigu.
The collected poemes of Kathleen Raine

Extraits du livre d’Anne Bancroft « Femmes en quête d’Absolu »

Voir la spiritualité comme la beauté et voir la beauté en toute chose constitue l’inspiration profonde de la poésie de Kathleen Raine.
Je nomme ces choses :
gorgée, aubépine, pluie,
Mais le sens poursuit son oiseau
Vif entre le gris et le vert.
Mystère qui n’est pas attaché par le mot. (Collected Poem 1935-1980.)
Sa poésie est éclairée par le sentiment que la seule vraie poésie – et en fait la seule vraie vie – est celle qui pénètre le transcendant. Une telle poésie donne au lecteur le sentiment des valeurs cosmiques et le transporte hors de lui dans une grande liberté d’esprit.

Énoncé du mystère, comment appellerons-nous
Un esprit revêtu du monde, un monde fait homme ?
(le Monde fait chair, Collected Poems 1935-1980)
J’ai lu tous les livres, mais un
Seul demeure sacré : ce
Volume de merveilles, ouvert
Toujours devant mes yeux. (Poèmes sans titre)
De l’Illimité :
Pour Kathleen Raine, toute grande poésie contient un élément transcendental – et nous pouvons substituer notre expérience de vie à ce qu’elle dit de la poésie. Les valeurs d’aujourd’hui, pense-t-elle, sont fondées non sur une intuition et une appréhension du sublime, mais sur la personnalité et sur le monde. La poésie centrée sur le moi et ses limitations ne peut jamais, selon elle, contenir le pouvoir transformateur et libérateur de cette autre poésie qui utilise les symboles cosmiques antiques, qui transmuent l’ordinaire en or et qui, comme les archétypes de Jung, sont enfouis au plus profond de notre subconscient.
“Ils viennent non comme une allégorie, mais comme des épiphanies, visions qui inspirent un respect mêlé de crainte, qui nous émeuvent profondément et inexplicablement. Ces images semblent déposées entre nos mains comme des signes que nous sommes invités à suivre encore et toujours, car ils nous tirent irrésistiblement, comme par magie ; et cela est vrai aussi bien quand nous les rencontrons dans la nature que quand nous le faisons dans les rêves et les visions. Nous les reconnaissons à leur nature sacrée. Ce n’est pas une curiosité académique qui nous les fait poursuivre jusqu’à leur source mystérieuse, mais un sentiment semblable à celui qui nous fait suivre la personne aimée et nous rend incapable de nous éloigner d’elle…
“Ils surgissent comme des impulsions vivantes, des poussées issues de notre propre être et par conséquent irrésistibles. Nous ne pouvons nous reposer avant de les avoir suivis jusqu’à leur source, ou aussi bien que nous le permet notre compréhension.” (The Land Unknown)
De tels symboles – fils d’or nous montrant la route à suivre – ont été présents, pense la poétesse, depuis le début de la civilisation. Ils ont été véhiculés par toutes les grandes oeuvres littéraires, et ont formé un langage que chacun doit découvrir. Mais beaucoup de gens refuseraient d’admettre la nécessité de retrouver un tel langage, car ils ne croient pas à la réalité d’un ordre spirituel. Kathleen Raine elle-même est convaincue qu’un tel ordre spirituel existe et qu’il vient de “l’ancienne anima mundi, l’âme du monde, dont parfois, éveillés ou en rêve, nous apercevons les images en nous émerveillant tant elles paraissent belles et chargées de sens.” “Certains, comme le poète romantique anglais Wordsworth, ont reconnu ces images incarnées dans une montagne, une cascade, un lac, un arbre.
D’autres, comme Dante, les ont vues dans la beauté d’une personne aimée : un pouvoir magique inexplicable qui illumine de l’intérieur.
“Qu’elle que soit l’apparence qu’elles revêtent – rêve, vision éveillée, contemplation ou incarnation dans une forme de la nature ou de l’art -, leur caractéristique tient à ce qu’elles semblent communiquer une signification essentielle. Elles signifient ce qu’elles sont et sont ce qu’elles signifient, des incarnations à la fois de la vérité et de la beauté, car elles émanent du réel que nous reconnaissons instantanément et inséparablement comme vrai et beau. Il en est nécessairement ainsi puisque c’est le fond de notre propre être, interrogeant et répondant tout à la fois, que nous sommes et incarnons. “ Les images symboliques viennent nécessairement du monde perceptible qui est, dans la nature des choses et de façon immuable, le ’donné’, inséparable de notre nature humaine d’être incarnés. Toute la connaissance de l’âme doit venir à elle dans les termes de ce monde de personnification…
« Vraiment compris, l’univers constitue un seul grand symbole, communiquant d’une manière sacramentelle, par une signature extérieure et visible, une essence intérieure et spirituelle. »
Kathleen Raine a découvert le langage riche de l’alchimie et de la kabbale dans les études qu’elle a menées tout au long de sa vie sur William Blake.
Mais un tel langage peut ne pas conduire tout le monde à l’éveil. Peut-être n’y a-t-il que quelques personnes comme Kathleen qui croient fermement au pouvoir qu’ont les images de nous transporter dans de nouvelles sphères de compréhension, fondant la plus grande partie de leur connaissance sur elle qui fut communiquée par les grands sages du passé tels que Platon et Plotin ? Pour elle, le vrai principe de la poésie est dans l’utilisation exacte de l’image symbolique qui peut transmettre au lecteur la prémonition d’un autre niveau de réalité, car elle croit fermement que chaque particule et chaque objet est le symbole et le signe d’une réalité transcendantale : “Nous avons autant le droit de jouir du monde et de le contempler que de le consommer. Le monde vivant est un livre de sagesse.”
La magie de l’enfance
Comme beaucoup d’entre nous, c’est dans son enfance que se trouve la clé de ce qu’elle allait rencontrer dans d’autres dimensions. Quand elle avait sept ans, pendant la Première Guerre mondiale, on l’envoya loin de Londres, aux confins du Northumberland. Les rues et les parcs des villes ne peuvent jamais satisfaire complètement la vue, l’ouïe et le toucher d’un enfant, alors que la campagne le fait à tout instant. Les nombreuses nuances de vert, par exemple, de la plus pâle à la plus intense, la majesté du ciel, le bruit du vent dans les arbres, la touche d’herbe tendre et des jeunes feuilles sont des expériences fondamentales qui, vécues par un enfant sensible et attentif, peuvent se conserver à jamais dans son cœur. Il en fut ainsi pour Kathleen Raine. Elle vivait avec sa tante, une institutrice, au Manse, une “maison tout à fait charmante de la campagne du Nord”. Le jardin du Manse était “ plein d’arbres, de fleurs et d’affleurements rocheux”. Après l’école et le samedi, elle pouvait partir en exploration.
“Comme un véritable aborigène, je connaissais dans un rayon d’autant de kilomètres que je pouvais parcourir en une journée chaque rocher, chaque cavité, chaque marais, chaque source et chenal de pierre, tous les arbres, toutes les plantes rares poussant dans les rochers, tous les nids de vanneaux et tous les tas d’os de moutons blanchis. Je connaissais mon île aussi bien que Caliban et Robinson Crusoé connaissaient les leurs.
“Après le thé, je partais en courant vers la lande qui s’étendait derrière la maison – en courant parce que l’endroit que j’aimais était loin de Manse. Je montais une pente de bruyère, descendais un rocher escarpé – un petit escarpement herbeux – puis remontais la longue pente suivante jusqu’à un second escarpement, plus sauvage, plus haut et plus pierreux, où poussaient des joncs secs et de dures fougères polypodes dont les racines, en grandissant, fendaient les rochers. Arrivée là, je n’étais jamais sûre du chemin à suivre, mais je finissais toujours par trouver l’endroit. Je descendais, mon pouls s’accélérant sous l’effet de la peur tandis que je m’agrippais sous mon poids. Après avoir traversé une petite cheminée calcaire et continué jusqu’à une corniche très étroite, je retrouvais ma chapelle secrète – ou quelque chose à mi-chemin entre une chapelle et un terrier de lièvre.
“Cette douce mer d’herbe fine avec le rocher qui s’élevait au-dessus d’elle, couverte d’une abondance de fougères telle que je n’en ai jamais vu, était pour moi ce centre et cet axe du monde que les êtres humains ne cessent de chercher. Par droit de naissance, chacun de nous est le centre de son propre monde. Mais bien souvent nous perdons ce sentiment et croyons que le centre est Paris, Moscou, les Trois Sœurs ou l’Oxford de Jude l’Obscur, ou les îles de Corail du Pacifique, les sources du Gange, ou la soirée à laquelle nous n’avons pas été invités. Ce sentiment de l’ici et maintenant nous échappe et nous le poursuivons, incapables d’être heureux tant que nous ne l’avons pas rattrapé, si nous y parvenons jamais ! Le monde est plein d’exilés, peut-être sommes-nous presque tous des exilés une partie de notre vie.
“Mais là, je possédais ce centre, et j’étais posée comme un oiseau sur son nid, en sécurité, invisible, faisant partie de la distance, avec le monde, le jour et la nuit, le vent et la lumière qui tournaient autour de moi dans le ciel. Il n’y avait plus aucune différence entre le lointain et le proche et j’étais dans le tout, aussi bien que mes yeux pouvaient voir, jusqu’à la tombée de la nuit. Le vent et la pluie étaient comme les éléments en ébullition dans un flacon de verre, pour mon esprit solipsiste d’enfant c’étaient la terre et le ciel en entier. Le soleil, les nuages, le vent dominant, le frémissement des roseaux secs, le ciel à l’Occident ne faisaient qu’un. Jusqu’à ce que la fraîcheur du soir, la pluie ou la peur de l’obscurité me ramènent en courant à la maison pour y trouver la sécurité du monde humain, moins parfait, dans lequel j’entrais en clignant des yeux quand je revenais dans la lumière de la lampe à pétrole de la cuisine.” (Farewell Happy Fieds)
Ces souvenirs d’enfance devaient venir la hanter tout au long de sa turbulente vie sentimentale. Après avoir obtenu sa licence de botanique à l’université de Cambridge, elle contracta un bref mariage qui ne dura pas, puis un autre, plus long, qui échoua également, dont naquirent un fils et une fille. Munie de peu d’argent et douloureusement engagée dans une nouvelle histoire d’amour malheureuse, elle emmena ses enfants, durant la Seconde Guerre mondiale, dans un petit presbytère éloigné du district du Lac. Là, elle retrouva le monde qu’elle pensait avoir perdu à jamais.
“C’était comme si la même multitude de perce-neiges avait attendu mon retour, et le bruit du ruisseau qui coulait à travers la prairie, le bruit du même feu brûlant toute la nuit que j’avais entendu, étendue dans mon lit, dans la chambre bleue du Manse. » (The Land Unknown)
La plénitude
Mais à présent, elle était une adulte et un poète reconnu, ses épreuves l’apparentaient à un pèlerin plein d’expériences. Elle était à même de connaître cette modification de l’état de conscience qui est la condition préalable à l’illumination.
“Pendant cet été 40 où la France tomba, je vivais donc dans un état et un lieu où tout était rayonnant de cette lumière intérieure sur laquelle a écrit Traherne. Dans la permanente illumination intérieure des mousses et des fougères, des pavots jaunes du Pays de Galles et de l’eau coulant sur des pierres reflétant le scintillement de la lumière pure, la chaleur du soleil sur le banc de pierre sous l’if, le parfum des jeunes feuilles de bouleau et des fleurs de tilleul, la ligne des collines changeantes dans le soleil et l’ombre, certains moments relevaient d’une sorte de conscience différente. Un tel état a été assez souvent décrit : Tennysson disait qu’il pouvait y entrer à volonté ; Richard Jefferies et d’autres l’ont bien connu. “Il se peut que le ’mysticisme de la nature’ occupe une place relativement modeste à l’échelle de la perfection qu’atteignent les saints et les sages. Mais face à la conscience normale, la différence est aussi grande qu’entre la terre et le paradis, bien que la comparaison ne soit pas précisément adéquate. La description d’états de conscience avec les termes des autres doit, à ceux qui n’ont pas eux-mêmes vécu d’expérience mystique, donner l’impression d’images figuratives ou poétiques (en tout cas quand, dans quelque domaine que ce soit, l’ignorance met le jugement au-dessus de la connaissance). Ceux qui savent sont pourtant unanimes à rapporter que les changements de conscience ne relèvent pas d’une question de degré, mais d’espèce. Ils ne correspondent pas à une émotion ou à une excitation fortes, mais à une clarté dans laquelle tout est perçu dans ses moindres détails, comme par un sens plus aigu.
“Sur la table où j’écrivais mes poèmes, je gardais toujours une coupe remplie de différentes espèces de mousses et de lycopodes, et je regardais longuement et profondément ces formes, pénétrant leur vert émeraude lumineux. Il y avait aussi une jacinthe qui poussait dans un vaste d’améthyste. Un soir, j’étais assise seule à ma table, la « lampe d’Aladin » allumée, le feu de bois brûlant dans l’âtre. J’étais paisible. Je regardais la jacinthe et, tandis que je contemplais la forme de ses pétales, la force de leur courbe pendant qu’ils s’ouvraient en s’enroulant vers l’extérieur pour révéler les centres mystérieux de la fleur, leurs anthères et leurs cœurs semblables à des yeux, brusquement je découvris que je ne regardais plus la jacinthe, mais que j’étais elle, par un changement de conscience distinct – indescriptible, mais en aucune manière vague, encore moins émotionnel -, dans la plante même. Plutôt, la plante et moi ne faisions qu’un et il était impossible de nous discerner, comme si la plante était une partie de ma conscience.
“J’osais à peine respirer, saisie par une sensation si aiguë que je pouvais sentir par mes sens l’écoulement même de la vie dans les cellules. Je ne percevais pas la fleur, mais je la vivais. J’avais conscience de la vie de la plante comme d’un écoulement lent ou de la circulation d’un courant vital de lumière liquide d’une extrême pureté. Je pouvais en appréhender comme une simple essence la structure formelle et le processus dynamique. La forme dynamique était, me semblait-il, d’un ordre non pas matériel, mais spirituel ; d’une matière plus pure, ou de la matière elle-même perçue comme esprit. Il n’y avait aucune émotion dans cette expérience qui était, au contraire, l’appréhension presque mathématique d’un tout complexe et organisé, appréhendé en tant que tout. “Le tout était vivant ; et en tant que tel il inspirait un sentiment de sainteté immaculée. Une forme vivante, c’est ainsi que je peux le mieux exprimer l’essence ou l’âme de la plante. Par ’vivante’, je ne veux pas parler de ce qui distingue l’animal de la plante ou la plante du minéral, mais plutôt d’une qualité qu’ils possèdent tous à différents degrés. Ou bien tout, dans ce sens, est vivant, ou bien rien ne l’est – cette négation étant la vision vers laquelle tend constamment le matérialisme, faute, comme je le savais à présent, d’une appréhension immédiate de la vie en tant que vie.
“L’expérience dura un certain temps – je ne saurais dire combien de temps exactement – et je retournais à la lente conscience humaine avec un senti- ment d’amoindrissement. Je n’avais jamais auparavant expérimenté quelque chose de semblable, ni ne l’ai fait depuis au même degré ; et cependant cela ne me parut pas étrange à ce moment-là, mais infiniment familier, comme si j’appréhendais enfin les choses telles qu’elles étaient, comme si j’étais dans le lieu auquel j’appartenais, où d’une certaine façon j’avais toujours été et où je serais toujours. Ce sentiment presque constant d’exil et d’expérience inachevée qui est, je suppose, le sentiment humain courant, avait disparu comme dans un film. Sur ces sujets, connaître d’un coup c’est connaître pour toujours. » ( Adieu Prairies heureuses – Ouvrage traduit en français mais épuisé)
La question fondamentale
“La question vraiment fondamentale est la suivante : le monde est-il une structure faite de matière qui peut être mesurée et manipulée, sans vie propre, l’être humain n’en étant qu’une partie surajoutée et irrécuparable ?
Ou bien y a-t-il un esprit éternel et immortel, ce qui impliquerait que c’est l’esprit et non la matière qui est originel, et que nous ne pouvons connaître la matière qu’à travers l’esprit qui l’observe depuis un niveau supérieur ? Telle est l’alternative traditionnelle qui a toujours existé ? Si vous choisissez la première solution, elle vous mène au nihilisme et à la destruction du monde. Si vous choisissez la seconde, vous continuez sans fin à l’explorer. Vous êtes toujours au commencement des choses. Je voudrais demander aux jeunes de rejeter la vision matérialiste, qui est fausse et a conduit à une terrible dégradation de l’image de l’être humain (selon celle-ci, l’être humain n’est qu’un accident dans le grand mécanisme de cet univers, nous ne sommes rien, et la destruction est imminente ). C’est vraiment une conception totalement erronée de ce que nous sommes et de ce qu’est l’univers, parce que le mesurable a été mis à égalité avec la réalité ; et l’on a graduellement contesté à l’incommensurable – qui inclut la conscience elle-même – sa primauté en tant que point de départ de toute connaissance quelle qu’elle soit. Je voudrais que les jeunes croient que nous sommes des esprits vivants, que nous sommes des âmes vivantes et des enfants de l’esprit éternel, qui est la source divine de toutes choses, de l’univers aussi bien que de nous-mêmes. Je pense que de cela s’ensuit tout le reste. Cette croyance revient à faire demi-tour et à regarder dans l’autre sens. Une fois que vous voyez que l’être humain porte la signature de Dieu, vous ne pouvez traiter les gens comme ils se traitent, eux, mutuellement.
On peut parler de Dieu non comme d’une personne, mais comme de la personne de l’univers. »
Ouvrages traduits en français (épuisés à trouver d’occasion) :
– Adieu, prairies heureuses
– Le royaume invisible
– La gueule du lion
– William Blake
– L’imagination créatrice de William Blake